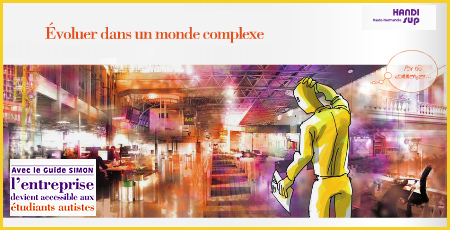Ce que nous apprennent les robots… sur nous-mêmes
Les robots sont bêtes comme leurs pieds. Ils ne pensent pas : ils exécutent les ordres. S’ils tombent, loupent une marche ou échouent dans une tâche, c’est que les approches, les programmes imaginés par des roboticiens sont erronés. Et c’est bien ce qui les rend aussi intéressants pour les biologistes. « Car les robots sont de fait un excellent moyen de mettre à l’épreuve les théories établies par les biologistes« , explique Alain Berthoz, professeur au Collège de France et qui a beaucoup contribué au développement des relations entre les roboticiens et les biologistes en France.
L’idée n’est pas nouvelle. Elle émerge dès les années 1950 et devient réalité dans les années 1970. A l’époque, un Russe, Viktor Gurfinkel, montre qu’une araignée-robot, dont les pattes sont chacune commandée indépendamment, peut monter des escaliers. Ce faisant, il suggère que, contrairement à ce qu’affirment les écoles de physiologie américaine et européenne de l’époque, le contrôle du mouvement n’est pas obligatoirement géré par un système centralisé comme le cortex moteur. Il peut aussi se faire de façon décentralisée. L’histoire lui donnera raison, puisqu’une partie des mouvements est en fait gérée par la moelle épinière.
Plus récemment, les robots ont permis d’avancer sur les questions liées à la motricité ou à la navigation dans l’espace. Par exemple, un humain dispose d’une infinité de possibilités pour attraper un objet. En l’absence de contraintes, comment choisit-il son geste ?
Une théorie récemment émise postule qu’il calculerait sa gestuelle en minimisant l’énergie déployée par certaines cellules nerveuses, les motoneurones, au cours de l’effort. D’abord modélisée, cette hypothèse a été testée au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS) du CNRS de Toulouse sur un bras robotisé. Celui-ci s’est en effet mis à imiter la gestuelle humaine. « L’usage des robots permet de vérifier la qualité d’un concept« , avertit Jean-Paul Laumond, directeur de recherche au LAAS, « mais il ne permet pas de valider l’hypothèse. »
Meilleure compréhension de la maladie de Parkinson
Dans un tout autre domaine, les efforts des roboticiens pour copier les processus à l’oeuvre dans certaines parties du cerveau ont permis d’avancer dans la compréhension de certaines pathologies mentales. Par exemple, en modélisant le fonctionnement des ganglions de la base, une région cérébrale impliquée dans l’apprentissage, des roboticiens ont permis de mieux comprendre la maladie de Parkinson et de proposer des hypothèses que les neurophysiologistes pourront à leur tour tester. « Les patients atteints de Parkinson ont du mal à apprendre de leurs erreurs, explique Mehdi Khamassi, modélisateur à l’Institut des systèmes intelligents et de robotique (ISIR). Nous proposons un modèle explicatif basé sur une variation du taux de dopamine. »
Au-delà des modèles, les robots, lorsqu’ils entrent en interaction avec l’homme, peuvent être instructifs. Pour preuve, cette expérience conduite par les équipes traitement de l’information et systèmes (ETIS) de l’université de Cergy-Pontoise et le Centre Emotion (CNRS – université Pierre-et-Marie-Curie – La Pitié-Salpêtrière). « Nous avons créé un robot dénué de peau, de nez, de contour, de menton, mais capable d’exprimer des émotions sommaires« , explique Jacqueline Nadel, spécialiste de l’autisme.
Les chercheurs ont demandé à des volontaires de regarder des photos, des vidéos de visages expressifs et de robots expressifs dénués de visage. Grâce à l’étude des encéphalogrammes, ils ont pu montrer qu’en l’absence de visage l’homme restait capable de reconnaître une expression, que les informations « expression » et « visage » étaient en fait traitées de façon indépendante par le cerveau. « C’est d’ailleurs pour cela que l’on peut trouver une maison, une fenêtre ou un paysage expressif, commente Jacqueline Nadel (1). Une telle découverte aurait été impossible à faire sans l’usage d’un robot. »
Viviane Thivent
Source : http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/01/06/ce-que-nous-apprennent-les-robots-sur-nous-memes_1626369_3244.html
(LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 06.01.12 | 18h43)
(1) Jacqueline NADEL, Directeur de recherche CNRS, centre émotion (USR 3246)
![]() Jacqueline Nadel est directeur de recherche CNRS. Elle est spécialiste du développement de l’imitation et de l’émotion chez le jeune enfant et l’enfant avec autisme. Ses recherches s’insèrent dans un cadre interdisciplinaire où s’articulent en particulier la robotique épigénétique, le développement humain et les neurosciences cliniques. Elle participe dans ce cadre à de nombreux contrats notamment européens et collabore de façon suivie avec plusieurs équipes de modélisation et robotique. L’équipe interdisciplinaire ‘Psychopathologie et Développement’ qu’elle a longtemps dirigé à La Salpêtrière, au sein de l’unité mixte de recherche 7593 CNRS/Université Paris6 devient récemment ‘Développement et robotique épigénétique’, en co-direction avec Arnaud Revel, roboticien et modélisateur.
Jacqueline Nadel est directeur de recherche CNRS. Elle est spécialiste du développement de l’imitation et de l’émotion chez le jeune enfant et l’enfant avec autisme. Ses recherches s’insèrent dans un cadre interdisciplinaire où s’articulent en particulier la robotique épigénétique, le développement humain et les neurosciences cliniques. Elle participe dans ce cadre à de nombreux contrats notamment européens et collabore de façon suivie avec plusieurs équipes de modélisation et robotique. L’équipe interdisciplinaire ‘Psychopathologie et Développement’ qu’elle a longtemps dirigé à La Salpêtrière, au sein de l’unité mixte de recherche 7593 CNRS/Université Paris6 devient récemment ‘Développement et robotique épigénétique’, en co-direction avec Arnaud Revel, roboticien et modélisateur.
Conception de paradigmes expérimentaux innovants (Dispositif TV de désynchronisation de la communication, robot émotionnel avec Gaussier, robot agentif avec Billard, machine à communication facilitée avec Revel)
Découverte de la fonction de communication de l’imitation chez les enfants préverbaux (Nadel, J. Imitation et communication entre jeunes enfants. Paris : PUF, 1986). Application à l’autisme
Analyse du paramètre de synchronie comme primitive de la communication qui donne naissance à des collaborations en neurosciences cognitives (Contrat neuroinformatique avec le LENA ; contrat européen F6- IST-MATHESIS ) et à des applications dans le domaine de l’autisme.
Applications thérapeutiques avec les nouvelles technologies d’interface homme-machine (avec Revel)
Direction ou co-direction de 18 thèses dont 8 dans les 4 dernières années (Pierre Andry, Nadra Aouka, Priscille Gérardin, PHRC, Ouriel Grynszpan, Ken Prépin, Maud Simon, Ezster Somogyi, Claire-Marie Verdon).
Animation du réseau interdisciplinaire Autisme-Science (http://autisme.risc.cnrs.fr)
Direction de la revue ENFANCE, diffusée par les PUF
4 Contrats européens depuis 2002 Associate editor of Interaction Studies, Benjamin Publisher Comités scientifiques (Fondation de France Autisme, Orange Solidarité Autisme , Comité de Suivi Scientifique de l’Autisme (Ministère de la Santé, Délégation Générale de la Santé)
5 publications
![]() NADEL, J., & DECETY, J. (Eds.) (2002).Imiter pour découvrir l’humain. Paris : PUF
NADEL, J., & DECETY, J. (Eds.) (2002).Imiter pour découvrir l’humain. Paris : PUF
![]() NADEL, J., & MUIR, D. (Eds.) (2005).Emotional development. Oxford: Oxford University Press
NADEL, J., & MUIR, D. (Eds.) (2005).Emotional development. Oxford: Oxford University Press
![]() NADEL, J. (2005). Imitation et Autisme. In A. BERTHOZ et al. (Eds.), Autisme, Cerveau et Développement (pp.341-356). Paris. Odile Jacob.
NADEL, J. (2005). Imitation et Autisme. In A. BERTHOZ et al. (Eds.), Autisme, Cerveau et Développement (pp.341-356). Paris. Odile Jacob.
![]() NADEL, J. (2006). Does imitation matter to children with autism? In S. Rogers & J. Williams (Eds.), Imitation and the development of the social mind: Lessons from typical development and autism (pp. 118-137). New York: Guilford Publications
NADEL, J. (2006). Does imitation matter to children with autism? In S. Rogers & J. Williams (Eds.), Imitation and the development of the social mind: Lessons from typical development and autism (pp. 118-137). New York: Guilford Publications
![]() NADEL, J., SOUSSIGNAN, R., CANET, P., LIBERT, G., & GERARDIN, P. (2005). Two –month-old infants of depressed mothers show mild, delayed and persistent change in emotional state after non-contingent interaction. Infant Behavior and Development, 4, 418-425.
NADEL, J., SOUSSIGNAN, R., CANET, P., LIBERT, G., & GERARDIN, P. (2005). Two –month-old infants of depressed mothers show mild, delayed and persistent change in emotional state after non-contingent interaction. Infant Behavior and Development, 4, 418-425.
Source : http://www.umr7593.cnrs.fr/spip.php?article99&lang=en