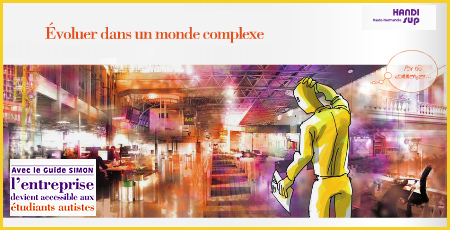La neuro-imagerie, outil de diagnostic pour l’autisme ?
L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (FMRI) est un outil récent et très populaire dans la recherche sur le cerveau. Elle ne constitue toutefois pas le seul progrès en matière de neuro-imagerie. Ainsi, le texte suivant s’attachera à en présenter trois autres :
- la tomographie d’émission de positron,
- la spectroscopie par résonance magnétique
- la magnétoencéphalographie,
qui représentent aussi trois nouvelles façons d’étudier l’autisme.
« La tomographie d’émission de positrons (TEP) est employée pour
analyser la synthèse de sérotonine,
ainsi que d’autres aspects de l’autisme chez les enfants« , dit la pharmacologue Diane Chugani, Ph.D et chercheur d’une université de Detroit.
La sérotonine suscite d’ailleurs l’intérêt des scientifiques depuis que l’on a découvert des niveaux anormalement élevés de ce neurotransmetteur dans le sang de plusieurs autistes. Ce n’est toutefois que depuis 1998 que l’étude de sa synthèse dans le cerveau est devenue possible; elle l’est grâce au développement d’une substance appelée AMT, qui permet au scanneur TEP de détecter un précurseur de sérotonine. Dans un deuxième temps, les chercheurs peuvent alors, par extrapolation, évaluer la quantité de sérotonine produite par le cerveau.
En ce sens, le Dr Chugani et ses collègues emploient l’AMT et la TEP pour étudier la synthèse de la sérotonine chez les autistes âgés entre 2 et 14 ans. Des anomalies dans la synthèse de sérotonine ont par ailleurs déjà été décelées dans des zones spécifiques du cerveau chez des enfants autistes.
« Les zones affectées font partie d’une section responsable de la discrimination sensorielle fine,
et les enfants autistiques présentent souvent des anomalies sensorielles« , indique le Dr Chugani. Il est donc possible que ces régions cervicales puissent être particulièrement vulnérables s’il y a un déséquilibre dans la sérotonine, ou un problème de régulation de cette substance pendant le développement.
La spectroscopie par résonance magnétique (SRM) ouvre un nouveau chapitre sur la chimie du cerveau, en identifiant et en mesurant certains de ses produits chimiques grâce à leurs signaux radio caractéristiques captés par la SRM. Les scientifiques emploient cette technique pour vérifier, notamment, la thèse que les autistes ont souvent des cerveaux plus volumineux que la moyenne. À titre d’exemple, une étude se concentre sur les produits chimiques du cerveau qui contiennent du phosphore : ceux-ci concernent des membranes cellulaires en construction et des produits de dégradation. Une recherche préalable concentrée sur le lobe frontal a par ailleurs montré que
l’autisme d’un patient s’aggravait quand la production de membranes cellulaires diminuait et que la dégradation augmentait.
Dans une autre étude, les chercheurs emploient la SRM pour observer si les processus normaux de réduction synaptique et d’apoptose propres au développement des jeunes enfants opèrent normalement chez les autistes. « Des failles dans l’un ou l’autre de ces processus peuvent accroître la taille du cerveau« , dit le psychiatre Stephen Dager, de l’Université de Washington. Ses collègues et lui étudient des autistes âgés entre 3 et 6 ans pour détecter des changements dans les niveaux de N-acetylspartate (NEA), de choline, de créatine et de lactate.
Le NEA fournit une mesure de densité neuronale, et la choline, la créatine et le lactate peuvent être utilisés pour mesurer les ruptures de membranes cellulaires.
« À l’intérieur d’une certaine période, des changements de proportions de ces produits chimiques dans le cerveau des autistes, en comparaison avec ceux des autres enfants, peuvent montrer aux chercheurs si l’apoptose et la réduction synaptique se poursuivent normalement« , explique le Dr Dager.
Pour sa part, la magnétoencéphalographie (MEG) mesure les minuscules champs magnétiques produits par les courants électriques des neurones, près de la surface du cerveau. À l’Université du Colorado, entre autres, les chercheurs emploient la MEG pour étudier le traitement des signaux dans le cortex sensoriel primaire, qui peut être altéré chez les personnes autistes.
Selon le psychiatre Martin Reite, « Si le processus sensoriel est altéré à la source, alors il est clair qu’il va y avoir perturbation… aux étapes en aval du processus« . À ce stade-ci, il croit que la MEG est un outil tout désigné pour étudier ces dysfonctionnements.
À l’Université de l’Utah, des chercheurs emploient aussi la même technique, cette fois-ci, pour
étudier l’association entre l’autisme et l’épilepsie.
Environ un tiers des enfants autistes subissent des attaques, mais comme elles commencent rarement avant l’adolescence, cela suggère que
l’activité épileptique ne cause pas l’autisme.
Les études du MEG, cependant, indiquent que
beaucoup d’enfants autistes qui ne souffrent pas d’attaques montrent quand même une activité épileptique
dans le cerveau, particulièrement pendant leur sommeil. Le Dr Jeffrey David Lewine et ses collègues de l’Utah présument que l’activité épileptique freine la formation des réseaux neurologiques dans les zones du langage et les lobes frontaux du cerveau, ce qui se traduirait par des symptômes autistiques.
Au fil du temps, le développement des techniques de neuro-imagerie nous permettra peut-être de vérifier ces allégations, ce qui influencera aussi les découvertes en matière de traitement.
Review of American psychological association, vol. 29, no 11