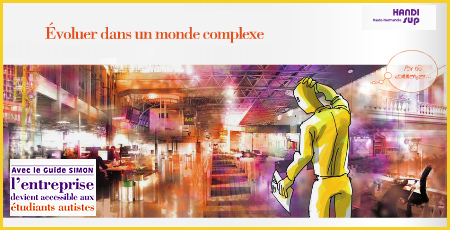Pensée visuelle et sentiment de soi – par Barbara Donville
Qui est Temple Grandin ?
« J’avais six mois quand ma mère s’est rendue compte que je me raidissais dès qu’elle me prenait dans les bras. Quelques semaines plus tard, alors qu’elle me câlinait, je la griffai, comme un petit animal pris au piège, pour échapper à son emprise »… Le diagnostic tombe comme un couperet : Temple est autiste. Pourtant, rien n’en restera là, grâce à la volonté farouche d’une mère obstinée, mais aussi grâce à son caractère éminemment déterminé, Temple Grandin déjouera le verdict des experts. Elle suivra une scolarité régulière et entreprendra des études supérieures qui la mèneront vers une carrière internationale comme conceptrice d’équipements agro-alimentaire. Aujourd’hui, elle enseigne également la science animale à l’université de Colorado, et est l’auteur de nombreux articles sur l’autisme et d’ouvrages qui ont connu une renommée mondiale : « Ma vie d’autiste » [1] Parut en 1986, « Penser en images » [2] , en 1995, et son dernier livre « l’interprète des animaux » [3] en 2003, ont été traduits en plusieurs langues, et la traduction française a été assurée par les Editions Odile Jacob.
Temple Grandin nous fait entrer dans le monde de l’autisme de façon intérieure et intime. Son témoignage est étonnant, mais il est surtout bouleversant. Plein d’espoir, il nous fait toucher du doigt cette extraordinaire différence qu’est l’intelligence autistique. Son expérience prouve qu’il ne faut jamais renoncer, car dans la vie tout est toujours chemin ! C’est par son geste que l’homme naît à lui-même. Mais il ne vit pas d’assurance, il vit de convictions. Rien dans les choses humaines n’a part à l’absolu. Temple Grandin est le vivant exemple que chacun de ces enfants a un talent profondément enfoui au fond de lui qu’il faut aider à manifester en actions et en œuvres. C’est en mettant des mots sur ce monde mental, et notamment sur le fonctionnement de son système de pensée, cette « pensée en images » que Temple Grandin nous fait saisir qu’il y a une logique, que l’autisme n’est pas une « forteresse vide », mais que cette logique obéit à un système de pensée qui offre exclusivement une vision du monde et non une visée comme c’est le cas dans la pensée verbale.
Qu’est-ce que la pensée visuelle ?
Penser en images est en effet un système spécifique. Si ce mode de pensée est extrêmement courant dans l’autisme, il n’est pas l’apanage de cette pathologie. En effet, 3% des hommes sont des penseurs visuels et cette remarquable faculté se rencontre plus fréquemment chez les musiciens et les mathématiciens.
Forgée par l’historien de l’art Rudolph Arnheim dans les années 1920, le concept de pensée visuelle [4] concilie les démarches esthétiques et cognitives du début du xxe siècle. Arnheim se définit lui-même comme un « psychologue du visuel pensant ». Dans un chapitre consacré à l’intelligence de la perception visuelle, il développe l’idée que la perception est assimilable à un phénomène cognitif : « je prétends que les opérations cognitives désignées par le vocable « pensée » loin d’être l’apanage de processus mentaux intervenant à un niveau bien au-dessus et au-delà de la perception, constituent les ingrédients fondamentaux de la perception elle-même ».
Arnheim définit l’intelligence visuelle comme une opération active de l’esprit pour lui « le sens de la vue procède de manière sélective. La perception de la forme consiste à mettre en œuvre des catégories formelles que l’on peut appeler concepts visuels en raison de leur simplicité et de leur généralité. Percevoir c’est aussi résoudre des problèmes ». Il s’agit donc avant tout pour Arnheim d’un autre registre d’intelligence, affirmant la fécondité conceptuelle de la forme visuelle et de la possibilité d’une pratique sensible aux objets de pensée.
Il existe en effet deux systèmes de pensées. D’une part la pensée verbale et conceptuelle qui engendre la prévalence d’une visée du monde, rejoignant en cela la conception transcendantale kantienne dans laquelle l’objet se constitue à partir de la visée du sujet ce qui entraîne donc un jugement du sujet sur ce qui l’entoure. Et, d’autre part, la pensée visuelle, qui procède d’une prévalence de la vision du monde, une vision d’où émane une constatation et non un jugement comme c’est le cas dans la pensée verbale et conceptuelle.
Arnheim pose ainsi la question de l’abstraction fondée sur la généralisation : « le rapport entre abstraction et généralisation trouve un écho dans l’éternelle controverse sur la nature et la valeur de « l’induction », l’induction communément définie comme « le processus permettant de découvrir les principes à partir de l’observation et la combinaison de cas particuliers » consiste à tirer des conclusions générales de que l’on peut observer dans un certain nombre de cas ».
Si le mode de pensée visuelle ne donne pas accès comme la pensée verbale à la générativité du cerveau, c’est parce que les processus cognitifs mis en œuvre pour rendre possible la perception adéquate ne permettent pas comme dans la pensée verbale, de percevoir les priorités correspondantes à l’ensemble d’un champ visuel donné. En effet « les première opérations mentales que l’on effectue dans des situations nouvelles ne constituent pas des actes de généralisation : la généralisation en effet doit toujours être précédée d’une distinction de cas perçus individuellement (c’est le rôle que Damasio attribue à l’arrière-plan corporel). Une généralisation de haut niveau en revanche, est d’entrée de jeu une qualité de la perception. C’est une généralité qui est le fruit d’une abstraction primaire dans la mesure où les différences qu’elle cache se situent bien au-delà du seuil du sens de la vue. » Cela explique donc pourquoi le penseur visuel ne généralise pas.
Temple Grandin se dit « prisonnière d’une vue d’ensemble ». Apprendre à voir les choses en relation prend probablement un certain temps. Et, l’important c’est que le processus cognitif qui produit les constances relève d’un ordre d’intelligence et de généralisation très élevé, puisqu’il permet d’évaluer n’importe quelle entité particulièrement par rapport à un contexte et que cette opération s’effectue en tant que partie intégrante de la perception active. De fait, la perception n’est susceptible d’abstraire des objets en tant qu’invariants de leur contexte que lorsqu’elle appréhende la forme comme structure organisée et non comme l’enregistrement d’une mosaïque d’éléments, phénomène qui se produit précisément dans la pensée visuelle liée à l’autisme.
Alors que le penseur verbal conçoit des schémas envisagés dans un contexte donné, le penseur visuel voit des données sensorielles brutes qui ne sont reliées d’emblée à aucun contexte et qui se livrent ainsi à ses sens. Il est en effet dans l’incapacité de filtrer les informations qui sont données comme partie prenante d’un contexte, et le monde se présente à lui comme « une masse ondoyante de détails sans liens particuliers les uns avec les autres » comme l’écrit Temple Grandin.
Dans son article intitulé « l’image, une vue de l’esprit », Bernard Darras [5] directeur du centre de Recherche images et cognitions, développe une thèse intéressante. Il cherche à mettre en évidence les différents processus cognitifs responsables de la production d’images chez l’être humain ainsi que les catégories et les classes d’images produites. Son objectif est de faire comprendre les disparités qui existent chez les individus vis-à-vis de la création, de l’expression et de l’imagination. Il a donc élaboré une hypothèse de base qu’il divise en deux catégories : d’une part la pensée visuelle pour laquelle il précise qu’il s’agit d’un ensemble cognitif, sémiotique et paradigmatique complexe dont le domaine de référence est celui de l’expression optique. « Par cette expérience optique, on assiste à l’accès à l’information à son traitement et à son fonctionnement cognitif », précise-t-il dans son article. Et d’autre part la pensée figurative qui est « cette pensée qui travaille avec un matériel dérivé de la perception visuelle, qui est entièrement construit par la machine cognitive », dit-il encore.
La production d’images peut donc se faire selon deux processus distincts. Et, il en résulte donc deux catégories d’images : d’une part, les similis qui sont des signes appartenant au répertoire optique et au type d’activité cognitive qui relève de la pensée visuelle, et d’autre part, les schémas qui sont des produits de la pensée figurative. Ce sont des images dont l’origine et la destination sont différentes des origines et des destinations des similis et ils appartiennent au domaine cognitif.
On distingue trois familles de schémas engendrées par un niveau d’abstraction distinct. Chaque niveau d’abstraction produit une famille de schémas déterminée par la nature des propriétés figuratives. Ceux issus du niveau super-ordonné dans lesquelles les propriétés sont très générales avec un niveau d’abstraction élevé ; ceux issus du niveau subordonné où le matériel est emprunté aux propriétés figuratives mémorisées par l’individu ; et enfin ceux issus du niveau de base, qui sont des schémas consensuels de types iconotype. Ces derniers ont l’avantage d’avoir des qualités de communication et d’être partagés entre un grand nombre d’individus. Ce sont ces iconotypes communicationnels dont les répétitions enclenchent la mémoire procédurale.
De fait, il y a effectivement des disparités d’imaginations, de capacités de création et d’expression entre les individus. Ce serait donc à cause de ce fait que ceux qui se fondent uniquement sur des iconotypes pour communiquer, mobilisent moins leurs compétences créatrices que ceux qui comme les penseurs verbaux n’ont pas la nécessité de passer par l’iconotype.
Créer, inventer n’ont donc pas la même signification chez le penseur verbal et le penseur visuel. L’abstraction n’étant pas de mise dans la pensée visuelle, créer pour le penseur visuel n’est pas envisager à partir de rien comme c’est le cas pour le penseur verbal. Pour les penseurs visuels, les mots sont une seconde langue, dans leur tête défilent le film de leurs pensées et ce processus s’effectue sans un seul mot. En effet, tout type d’idées se présente à lui tout d’abord en images. La pensée s’emmagasine comme un CD Rom et quand elle doit être retrouvée par le sujet, il fait dérouler les menus de son CD Rom afin de retrouver l’information qui l’intéresse. Pour imaginer le penseur visuel partira d’une image précise dans sa tête et cherchera dans ces CD Rom à assembler différents éléments préexistants dont il se servira un peu à la manière d’un recyclage pour constituer ce qu’il veut créer. Ainsi, le concept d’imaginaire dans ce système de pensée est à comprendre de manière littérale. Le penseur visuel cherche en effet dans sa banque de données imagée une possibilité d’assembler nouvellement les éléments déjà préexistants. Certains penseurs visuels dont fait partie Temple Grandin développe également une pensée figurative qui donne la capacité de constituer un objet qu’il veut concevoir en trois dimensions. Temple Grandin témoigne : « j’ai commencé à faire des essais en trois dimensions dans ma tête. J’ai essayé différents modèles dans ma tête. J’y ai fait passer les bêtes…la première chose que j’ai fait a été de m’imaginer à la place des animaux et de voir avec leurs yeux ». Ce témoignage nous fait toucher du doigt une possibilité d’empathie par l’image, autre que celle dont fait preuve le penseur verbal. Il ne peut s’agir en effet ici d’un développement de l’empathie par le ressenti, comme processus premier telle que cela se produit dans la pensée verbale, mais bien d’un développement de l’empathie par la capacité à imager un vécu, et de le traduire par l’image. Certes la différence essentielle entre les deux formes d’empathie se situe dans le fait que l’empathie dans la pensée verbale envisage alors que l’empathie dans la pensée visuelle constate, prend acte en quelque sorte. Nous verrons plus loin en quoi combien cette empathie par l’image a de conséquences sur la faculté à développer une certaine forme de sentiments de soi et un certain type de profil émotionnel.
Temple Grandin témoigne tout au long de son livre de la constitution primordiale de l’image comme compréhension et appropriation du monde qui engendre de fait des conséquences sur sa capacité à s’exprimer verbalement. En effet, la pensée verbale abstrait tout concept et il n’est jamais nécessaire au penseur verbal de passer par l’image pour intégrer un concept générique : « le concept de chien est inextricablement lié à chacun des chiens que j’ai connu dans ma vie. Je n’ai pas d’images génériques du danois ou du chien loup ». Or, en effet le penseur visuel ne peut donc pas créer à partir de rien et doit toujours partir d’éléments déjà existants. Temple Grandin témoigne encore : « pour créer de nouvelles images, je pars toujours de mille morceaux d’images que j’ai emmagasinées dans ma vidéothèque de mon imagination et je les recolle ensemble ». Comme ils pensent en images, les penseurs visuels ont du mal à apprendre ce qui n’est pas traduisible comme tel. Certains mots traduisant des concepts spatiaux ou encore des concepts moraux sont extrêmement difficiles à intégrer pour eux : « j’ai du mal à apprendre ce qui ne se traduit pas en images… les mots qui servent à indiquer une position spatiale comme au-dessus ou en-dessous n’ont aucun sens pour moi tant que je ne n’ai pas été capable de les relier à une image visuelle… je visualise aussi les verbes. Le verbe sauter déclenche chez moi un souvenir de courses d’obstacles que nous organisions à l’école primaire. » Les mots n’ont donc d’emblée aucun sens pour eux et pour qu’ils prennent sens, il faut qu’ils les relient à une situation concrète imagée constituée par eux.
En effet, le concept devant-derrière, par exemple est très difficile pour eux car ce qui se trouve derrière moi va se trouver devant la personne qui me fait face et pour intégrer cette situation cela requiert une constitution subjective d’emblée pleinement unitaire et synthétique. Or, la pensée visuelle est avant tout celle d’une subjectivité éclatée et analytique qui ne permet pas au cerveau de généraliser rapidement à l’instar de la pensée verbale. Quant aux articles indéfinis comme « un » par exemple qui engendre une idée d’unité ou « du » article partitif qui induit une union implicite des deux articles « de et le », ils restent souvent longtemps incompréhensibles pour le penseur visuel. Temple Grandin dit également que certaines conjugaisons comme le verbe être n’ont aucun sens pour elle : « Certaines conjugaisons comme le verbe être n’ont aucun sens pour moi car j’ai bien des difficultés à m’offrir une identité stable et définie ».
Enfin, des concepts aussi abstraits et aussi subjectifs que volonté, honnêteté, culpabilité, honte, restent étrangers pour les penseurs visuels qu’ils soient autistes ou non, ces termes n’engendrent en eux aucun ressenti propre, ce ne sont que des mots ! En effet, le système de pensée visuelle est séquentiel, et fait que le penseur visuel a bien du mal à se percevoir comme un être unitaire et son niveau langagier se développe donc lentement et restera bien souvent médiocre.
La pensée visuelle obéit avant tout à une logique associative : un penseur visuel nullement autiste raconte que pour se représenter l’idée de « froid », il voit dans sa tête une glace. Rien ne fait sens pour le penseur visuel s’il n’a pas au préalable constitué dans sa tête une représentation imagée du concept énoncé par le mot. Tant que le concept n’est pas vécu par lui, il assiste dans sa tête à un perpétuel chamboulement sensoriel qu’il ne peut ni nommer ni mettre en images.
La pensée visuelle est d’abord et avant tout une pensée pré-langagière : d’après les travaux de Maria J.Krabbe qui a entrepris aux Pays-Bas des travaux dans ce domaine (beelddenken), alors que la forme linguistique est favorisée à l’âge adulte . Les jeunes enfants de 2 à 7 ans utilisent de préférence l’imagination visuelle. Plusieurs études témoignent en ce sens et nous citerons en particulier la très intéressante enquête menée il a environ quarante ans par Ralph Norman Haber [6] qui révèle chez les enfants de 2 à 8 ans une très forte capacité à utiliser la mémoire eidétique pour ensuite décroître jusqu’à disparaître totalement vers l’âge de 13 ans. Mais on peut évoquer également les travaux de Daniel Povinelli [7], anthropologue américain spécialiste des chimpanzés, qui a étudié leurs aptitudes sociales et qui délivre dans son livre une intéressante étude sur l’imaginaire des chimpanzés qu’il dit être visuel et qu’il qualifie également de pensée pré-langagière. D’une part, Povinelli et son équipe a remarqué l’extraordinaire sensibilité des chimpanzés à repérer le moindre détail dans leur environnement ; et d’autre part il évoque une étude de Nicholas Humphrey datant de 1998 qui stipule que les chimpanzés ont une bien meilleure mémoire visuelle que les humains et que les singes emploient une stratégie visuelle là où l’homme emploie une stratégie conceptuelle. Il suggère qu’il n’y a pas une infranchissable dichotomie entre les hommes et les chimpanzés dans leurs moyens à élaborer des concepts abstraits, mais plutôt les hommes ont déployé des capacités à concevoir une forme d’abstraction extrêmement élevée qui se réfère à des entités ou à des classes d’entités qui sont très difficiles à observer, et que cette spécialisation a laissé des traces dans le cerveau humain au niveau du traitement de l’information. Il fait ensuite un parallèle entre la pensée visuelle des chimpanzés et celle des autistes qui, dit-il, sont bien meilleurs que les hommes à des tâches répétitives. La pensée visuelle est une pensée non linaire et contrairement aux penseurs linguistiques ou verbaux, les penseurs visuels arrivent de façon intuitive à une conclusion. Les penseurs visuels ne raisonnent pas par le langage, mais en manipulant des symboles logico-graphiques, ils ont une logique hautement associative contrairement aux penseurs verbaux qui ont une logique déductive et linéaire. La pensée verbale en tant que langage possède deux dimensions : elle est linéaire et soumise au temps, engendrant une utilisation du langage général dont les mots font appel à un référentiel commun, alors que le penseur visuel a ses propres référentiels. Il ne s’agit pas de débattre sur la supériorité d’un système de pensée sur l’autre mais de comprendre que ce ne sont pas les mêmes hémisphères du cerveau qui sont utilisés : alors que le siège du langage se situe dans l’hémisphère gauche, le siège de l’image se situe dans l’hémisphère droit. Chaque système de pensée développe alors des capacités spécifiques à organiser un certain type d’information, ainsi de la pensée visuelle et figurative découlera la fascinante mémoire eidétique ou dite encore mémoire absolue telle que le décrit Borges dans une de ses nouvelles intitulée « la mémoire de Funes » dans Fictions [8]. Lorsqu’il s’adresse à quelqu’un, le penseur visuel traduit les images qu’il a dans la tête en mots. Autrement dit, le penseur visuel a besoin de voir pour dire.
C’est la visée du monde que développe la pensée verbale et linguistique, qui permet d’envisager la variation de la taille d’un objet non seulement comme organisée entre elles, mais encore comme liée de façon ordonnée à d’autres variations similaires qui se produisent simultanément dans le reste du champ visuel. Seule une pensée permettant d’envisager une visée du monde établit le caractère permanent d’un objet quand et parce que le milieu comporte des gradations perceptives ordonnées auxquelles l’objet se conforme. Autrement dit, les concepts demeurent génériques tant que leur application le permet. Percevoir un objet comme immuable, c’est être capable au plus haut niveau de généralité. Or, dans la pensée visuelle, l’objet est perçu de manière locale, il est enregistré à la manière d’un appareil de photos, de façon restrictive et le contexte est totalement ignoré.
On assiste alors à un phénomène de réduction eidétique dans lequel la taille et la forme de l’objet sont aplaties sur une surface à deux dimensions. Le paroxysme de ce phénomène est atteint chez le penseur visuel atteint d’autisme, et engendre le fait qu’une gamme de luminosité ne vaut pas pour la totalité du champ visuel, comme cela se passe dans le cerveau du penseur verbal. C’est en effet, cette capacité à déterminer l’apparence d’un objet indépendamment de son emplacement dans le champ visuel qui est en cause. Or, cette gamme de luminosité varie très souvent suivant une gradation spatiale. De fait, c’est justement cet enregistrement de la production de l’image comme gradation de tailles, qui, dans le cerveau d’un penseur verbal, vont en diminuant, qui permet de créer cette dimension de la profondeur. C’est précisément cela qui ne se produit pas dans la pensée visuelle autistique. La taille constitue l’un des facteurs qui déterminent la perception de la profondeur, or on remarque que certains penseurs visuels autistes ne développent pas la vision de la profondeur. C’est seulement parce que la luminosité ou les valeurs colorées d’un contexte donné sont perçus comme une échelle organisée que l’on peut assigner une place sur cette échelle à la luminosité et à l’objet. Il en va de même pour les gradations spatiales. Cette attitude réductrice qui se produit à son plus haut niveau dans la pensée visuelle autistique, montre qu’un objet donné change de caractère en même temps qu’il change de contexte.
La pensée visuelle, de ses aspects les plus fréquents à ses formes les plus anormales et extrêmes comme dans l’autisme par exemple, a pour corollaires que les penseurs visuels n’ont pas la même perception du monde que les penseurs verbaux. Cette prévalence d’une vision du monde sur une visée entraînent des conséquences importantes sur l’appréhension et la compréhension de l’environnement dans la mesure où le penseur visuel voit donc le monde tel qu’il se présente à lui à l’état brut, il n’en a pas une représentation comme c’est le cas pour le penseur verbal. Cela entraîne de fait, une vision hyperspécifique du monde. Qu’il s’agisse de la vue, de l’ouïe ou encore du toucher ou même du goût, tout est perçu de manière hyperéceptive car c’est à une avalanche de stimuli sensoriels à l’état brut que se heurte d’abord le penseur visuel. Le détail prévaut toujours sur le contexte qui n’a pas d’emblée de raison d’être.
Temple Grandin témoigne en ce sens : « Les autistes comme les animaux perçoivent tout un registre du monde visuel que les autres ne voient pas. Animaux et humains penseurs visuels sont extrêmement sensibles aux détails. Ils voient tout et réagissent à tout. Le problème essentiel est le contraste. Ils y sont tellement sensibles qu’un moindre changement leur est douloureux. » Cette vision hyperspécifique du monde entraîne une incapacité du cerveau à généraliser aussi rapidement que dans la pensée verbale, mais également l’impossibilité de se construire une identité aussi stable et définie comme cela le devient dans la pensée verbale, ce qui du point de vue des émotions, de l’intention, du ressenti entraîne une difficulté à entrer dans la nuance émotionnelle comme nous le verrons plus loin.
En ce qui concerne la vision, ce mode sensoriel hyperspécifique qu’engendre ce système de pensée, fait que le penseur visuel est particulièrement sensible à la luminosité, mais aussi au moindre mouvement. Certes, cette hyperspécificité aux contrastes s’il atteint son paroxysme dans l’autisme, n’est une fois encore pas le lot spécifique de cette pathologie : « les contrastes et les reliefs sont perçus violemment ». Tous les penseurs visuels autistes ou non y sont sensibles. Cependant l’enfant autiste atteint parfois un haut degré de décomposition du mouvement qu’il s’agisse de l’éclat de lumière d’une lampe à la fascination que peut provoquer la mise en mouvement d’un objet, l’enfant semble alors happé par le moindre détail rien ni personne n’existe alors autour de lui. En effet, le penseur visuel autiste ou non a du mal à utiliser ses sens simultanément : l’homme dont nous parlions plus haut disait ne pouvoir utiliser ses sens que les uns derrière les autres. Alors que dans l’autisme cela se traduit à l’extrême par une entrée dans un rituel stéréotypé, le mode de pensée visuelle obligeant alors l’enfant à dissocier ses sens au profit du sens prévalent du moment.
Si l’on décèle souvent une hyperacousie chez l’enfant autiste penseur visuel, elle n’est pas l’apanage de l’autisme mais s’y manifeste dans ce cas précis à un très haut degré. Temple Grandin témoigne une fois encore : « Facteur de perturbation et non des moindres, les sons ainsi que toutes émissions sonores ou inhabituelles et aiguë…les sons aigus et intermittents sont encore pires, beaucoup plus dérangeants que les sons forts et prolongés. » Il n’est donc pas rare de voir l’enfant autiste penseur visuel, se boucher les oreilles lors d’un moindre bruit ou à des paroles que l’on prononcera devant lui sans force particulière.
Quant au domaine de la sensibilité tactile, son touché se sent agressé en permanence et chez l’enfant autiste cela se manifeste une fois encore à l’extrême et provoque parfois des difficultés au niveau de l’habillement notamment. Cela laisse à penser que le dérèglement sensoriel présent à l’excès dans l’autisme, mais toujours présent chez le penseur visuel en général, est donc dû à la façon d’appréhender l’environnement spécifique à ce système de pensée, plus qu’aux composantes symptomatologiques de l’autisme.
Quel que soit le système de pensée utilisé par l’individu, il permet à celui-ci d’organiser un certain type d’informations. Or, c’est du type d’informations que notre système de pensée peut gérer prioritairement que découle notre perception émotionnelle qui est elle-même engendrée par ce qu’Antonio Damasio appelle « le sentiment même de soi ». Or, ce mode visuel de pensée ne permet pas d’assimiler d’emblée émotionnellement tout type d’informations.
Les conséquences de la pensée visuelle sur le développement des émotions :
Il existe plusieurs niveaux émotionnels qui sont plus ou moins élaborés et qui ne requiert pas un même degré de conscience du sentiment de soi. Il y a d’une part les émotions universelles ou primaires qui sont ressenties par tous les individus qu’ils soient penseurs verbaux ou penseurs visuels et que nous partageons également avec les animaux. Mais, il y a également les émotions dites secondaires ou sociales ainsi que les émotions dites d’arrière-plan. Nous avons dit plus haut que la variété des réponses émotionnelles dépend en premier lieu du sentiment de soi. On comprend alors que si le penseur visuel, parce qu’il est enclin à voir le monde de manière hyperspécifique, n’a donc pas accès à l’ambivalence émotionnelle qui caractérise la pensée verbale, la variété des réponses émotionnelles qui l’atteint est donc plus restreinte de fait. En effet, plus les émotions induisent intimement une intentionnalité, plus le conflit mental prendra place de manière consciente et explicite. Or, ce sont les émotions d’arrière-plan comme le malaise ou la motivation dont vont découler les émotions sociales telles que l’embarras ou la culpabilité qui engendrent un ressenti ambivalent et mitigé qui font appel à une subjectivité synthétique et unitaire.
Temple Grandin explique que chez elle, si les émotions restent simples, c’est parce que ses lobes frontaux ne sont pas assez développés, or ce sont les lobes frontaux qui sont le siège de toutes les associations. Le cerveau des autistes n’est pas capable d’établir les connexions nécessaires et de ce fait, les émotions restent distinctes et compartimentées. Il y a une moindre connectivité des régions corticales entre le cortex et le subcortex. Les émotions sont en effet, des processus biologiquement déterminés qui dépendent de dispositifs cérébraux établis de façon innée. Cette compartimentation émotionnelle dû à une relative dissociation des deux parties du cerveau, fait que les émotions violentes ressemblent à de brusques orages qui éclatent et se calment aussi soudainement. Temple Grandin dit ne pas ressentir d’émotions telles que la culpabilité ou l’embarras ou encore l’avidité qui sont en réalité des émotions secondaires dites sociales. En revanche, elle ressent la peur ou la rage qui font partie des émotions primaires dites universelles et qui proviennent des cerveaux reptilien et mammalien.
Dans « L’Erreur de Descartes » [9] , Antonio Damasio stipule que les lésions de la matière blanche sous-jacente aux régions médianes et orbitaires des lobes frontaux réduisent considérablement la capacités à exprimer et ressentir les émotions alors que la motricité et le langage ne sont en rien affectés : « lorsque l’on constate des déficits dans le domaine du raisonnement et de la prise de décision, ainsi que dans celui de l’expression des émotions, alors que par ailleurs, le profil neuropsychologique est largement intact, on vérifie que la lésion implique surtout la région ventro-médiane du lobe frontal ; en outre le domaine personnel-social est celui qui est le plus perturbé ». Mais Antonio Damasio avance également que ce déficit dans le domaine du raisonnement couplé à un déficit d’exprimer et de ressentir des émotions (ce qui est la caractéristique de l’alexithymie), peut également se présenter, seule ou en compagnie d’autres troubles neuropsychologiques, à la suite de lésions dans d’autres régions du cerveau.
Les émotions complexes (dont font partie les émotions secondaires ou sociales et les émotions d’arrière-plan dont nous parlerons plus loin), proviennent également des cerveaux reptilien et mammalien, mais elles passent par le cortex. Ce qui veut dire que les émotions secondaires et d’arrière-plan s’élaborent à partir des émotions primaires mais avec une réflexion et surtout une interprétation de soi par rapport à l’environnement que n’ont pas les émotions primaires. Dans les émotions d’arrière-plan, les réponses constitutives sont plus proches du for intérieur vital et leur cible est plus interne qu’externe. De fait, elles sont généralement compromises lorsque le niveau fondamental de la conscience, la conscience centrale, est lui aussi compromis, ce qui se produit dans le système de pensée visuelle à un degré plus ou moins élevé dont le paroxysme est représenté dans l’autisme une fois encore.
Or, chez le penseur visuel, la filtration des informations communiquées aux lobes frontaux ne fonctionne pas comme chez le penseur verbal et engendre donc une hyperperception du détail et une vision hyperspécifique de l’environnement. En effet, c’est le néocortex, couche supérieure du cerveau, qui comprend toutes les structures où sont localisées les fonctions cognitives, qui permet de développer et d’éprouver les sentiments contradictoires menant à l’ambivalence émotionnelle. Chez le penseur visuel, seules les émotions universelles sont réellement perçues. L’homme dont nous parlions plus haut me disait que son système émotionnel faisait qu’il ressentait toujours une émotion franche et que ses émotions apparaissaient les unes derrière les autres, mais qu’il ne ressentait jamais d’ambivalence émotionnelle. En effet, dans le système de pensée visuelle, les émotions sociales et les émotions d’arrière-plan sont absentes, seules persistent les émotions universelles, car pour avoir accès à l’émotion sociale et à l’émotion d’arrière-plan, il faut avoir accès à l’implicite et c’est fondamentalement ce qui est absent dans le système de pensée visuelle. Mais pour avoir accès à l’implicite, il faut pouvoir développer la possibilité de ressentir ce vécu, vécu comme non vécu que possède le penseur verbal, mais qui est tout à fait étranger au penseur visuel. En effet, le penseur visuel ne le peut pas : il lui faut vivre l’événement pour éprouver un ressenti. C’est parce qu’il a une visée du monde que le penseur verbal peut envisager le ressenti qu’il éprouvera s’il a tel sentiment dont pourra découler telle ou telle émotion, alors qu’il s’agit en réalité d’un sentiment et d’une émotion qu’il n’éprouvera peut-être jamais si tel événement ne se présente pas dans sa vie. Et c’est parce qu’il n’a qu’une vision du monde tel qu’il se présente ici et maintenant que le penseur visuel n’a pas accès à ce mécanisme mental.
Nous avons dit plus haut que le penseur visuel n’a pas la capacité comme le penseur verbal de développer une visée du monde. Celui-ci développe une vision du monde tel qu’il se présente, le penseur visuel ne peut que constater la vision qu’il a de son environnement, il ne peut le juger à l’instar du penseur verbal. Cette prévalence de la vision du monde sur la visée, engendre une certaine forme de sentiment de soi éclatée et analytique qui ne donne pas accès à l’ambivalence émotionnelle. En effet, l’ambivalence émotionnelle est très directement liée à l’idée de conflits mentaux qui se développent essentiellement avec les émotions d’arrière-plan qui sont les émotions qui s’impliquent le plus profondément dans la construction de l’intentionnalité du sujet, mais aussi à l’idée d’invariance structurelle et de continuité de référence du Soi. L’ambivalence émotionnelle permet en effet d’engendrer chez le sujet une référence singulière et stable, car ce n’est que lorsque l’on a accès à l’ensemble de la panoplie émotionnelle que l’on développe alors cette singularité individuelle d’où émane une stabilité du Soi. Chez le penseur visuel les sentiments sont plus francs que chez le penseur verbal et les émotions restent de ce fait plus simples. Le penseur visuel a une moindre capacité à dissimuler ses émotions, il ne peut les déguiser. Les émotions mitigées sont absentes chez lui, le penseur visuel ne ressent pas comme le penseur verbal de tourments affectifs. Il existe bien entendu une gradation dans l’émancipation de ce type de ressenti et le plus haut degré de cette monovalence émotionnelle est atteint par les penseurs visuels autistiques telle que le décrit Temple Grandin dans son livre.
Cette hypersensibilité au détail que nous avons déjà évoqué plus haut, et notamment cette hypersélectivité visuelle engendre donc une impossibilité de se faire une idée générique d’un objet et entraîne une impossibilité de développer des sentiments mitigés entraînant comme c’est le cas dans la pensée verbale des émotions nuancées : l’ambivalence émotionnelle n’est pas de mise dans la pensée visuelle car le contexte n’est jamais pris en compte. Etymologiquement le terme contexte engendre une idée « d’assemblage ». Contextus, le « contexte » par définition est un ensemble de textes qui entoure un élément, or l’étymologie de textus signifie tissu, trame, d’où émane une idée de sens. « Contextere » veut dire effectivement littéralement « tisser avec ». Et, c’est clairement ce « lien avec » qui ne se fait pas chez le penseur visuel. Celui-ci ne perçoit le monde que d’une façon locale, fractionnée, qui n’implique jamais ni explicitement d’emblée, ni a fortiori implicitement la moindre conscience d’un lien quelconque.
En ce qui concerne les sentiments de douleur et de souffrance, par exemple, Temple Grandin fait un parallèle entre la façon de ressentir ce phénomène chez les animaux et chez les autistes penseurs visuels. Elle attribue la moindre acuité à la douleur à un développement défectueux des lobes frontaux. Or, ce sont eux qui associent intimement les circuits sensoriels et les circuits émotionnels. C’est encore eux qui censurent et maîtrisent toute forme d’excès y compris les cris et la douleur. Or, chez le penseur visuel autiste ou non, la douleur est souvent mal interprétée et mal localisée. L’activité du cortex préfrontal est associée à une réduction de la peur (pas de l’anxiété). Les penseurs visuels souffrent moins mais ont plus peur, cela est dû à leur façon d’appréhender le monde trop détaillé qui ne leur donne pas les moyens de faire face à l’inattendu. C’est la déficience des lobes frontaux qui fait qu’ils ont un moindre contrôle sur le cerveau. En ce qui concerne la peur ou la fuite, qui est une réaction très courante chez l’enfant autiste, si la peur est une réaction à une menace extérieure, la fuite est elle, une réaction à une menace intérieure, et Temple Grandin pense qu’il y a donc deux systèmes émotionnels distincts pour traiter ces deux réactions. Or, l’aspect sauvage que l’on constate à un très haut degré dans l’autisme mais qui est toujours existant chez tous les penseurs visuels en règle générale, est lié entre autre au traitement défectueux (inexistant ou à tout le moins trop lent) de l’information. Les mots ayant du mal à sortir et les perceptions à s’accorder, une phase d’apprivoisement dû à une moindre généralisation du cerveau est nécessaire. Chez le penseur visuel, la généralisation du cerveau étant plus lente, le phénomène d’association qui devrait se faire au niveau du cortex, ne se fait pas ou se fait mal. Les peurs développées sont donc différentes du fait de l’impossibilité d’appartenir à un phénomène associatif comme c’est le cas dans le système de pensée verbal. De fait, les émotions chez le penseur visuel sont alors hyperspécifiques ainsi que leur façon de percevoir le monde, car la pensée visuelle sélectionne d’emblée les différences et non les ressemblances, comme c’est le cas dans la pensée verbale. Le système nerveux du penseur visuel se focalise alors sur le détail et ne l’analyse pas et rien ne peut être envisagé comme un tout dans la mesure où les fonctions associatives du cerveau sont amoindries.
En conséquences, chez le penseur visuel en général et chez le penseur visuel autiste à un très haut degré, les mécanismes de défenses tels que la projection ou encore le transfert, le refoulement ou le déni sont pour ainsi dire absents ou à tout le moins très amoindris. Des mécanismes de défense comme l’humour, l’altruisme, l’intellectualisation qui permettent de repousser l’émotion réelle chez le penseur verbal sont absents chez le penseur visuel : il ne sait pas interpréter l’autre car il ne sait pas s’interpréter par rapport à l’autre, il ne peut que constater. En effet, tous ces mécanismes dépendent du refoulement, et ce refoulement permet de reléguer dans l’inconscient tout ce qui met mal à l’aise, de manière à libérer la conscience. Ce mécanisme est rendu possible chez le penseur verbal parce que ce dernier porte un jugement, donc établit une distance psychique entre ce qu’il est et ce qu’il veut laisser paraître au monde de lui-même, il a une capacité de dédoublement de son propre ressenti qui est tout à fait absente chez le penseur visuel. Dans la pensée visuelle qui ne fait que voir tel quel le monde qui se présente, le refoulement n’a pas lieu d’exister. Les mécanismes qui sous-tendent la pensée visuelle ne permettent pas d’entrer dans les croyances d’autrui, or c’est bien de cela qu’en réalité le penseur verbal cherche à se libérer quand il entre dans le refoulement ou dans le déni. Temple Grandin dit ne pas avoir d’inconscient. Elle dit ne rien pouvoir refouler car cela suppose une capacité de filtration des informations, dans un processus de face à face engendrant un conflit mental et une éventuelle inhibition, or c’est justement ce qui lui fait défaut. Lorsqu’elle assiste à une scène pénible, elle se souvient d’absolument tout, elle ne peut rien inhiber : elle se souvient des moindres détails. En situation de danger, elle dit ne pas être capable comme le penseur verbal de faire comme si de rien n’était. Elle ne peut que constater le danger et le vivre comme tel
Cette hyperspécificité que l’on retrouve au niveau de tous les sens chez le penseur visuel, se fait également sentir dans la gestion des émotions et fait que le cerveau généralise mal ou pas et qu’il faut à celui-ci un temps d’habituation et de familiarisation pour intégrer un ressenti émotionnel. Un cerveau qui généralise mal, n’associe pas bien et se met donc à catégoriser et cette impossibilité à généraliser correctement entraîne du point de vue émotionnel un développement amoindri du sentiment de soi et donc l’impossibilité de développer certaines catégories émotionnelles qui entraînent une incapacité de développer aussi pleinement l’intentionnalité que dans la pensée verbale ainsi que la capacité d’intégrer pleinement l’utile et l’utilisable. La pensée visuelle développe donc une vision hyperspécifique du monde d’où découle des émotions hyperspécifiques et un sentiment de soi amoindri, car les sentiments et les émotions chez le penseur visuel sont motivés exclusivement par le détail jamais relativisé par le contexte.
Cette hyperperception du détail est dû une fois de plus aux déficiences des lobes frontaux qui ne fonctionnent pas normalement chez les autistes et qui, de manière générale fonctionnent différemment chez le penseur visuel et chez le penseur verbal. C’est dans le néocortex qui est la couche supérieure du cerveau que se situent toutes les structures où sont localisées les fonctions cognitives. Chez le penseur verbal, le néocortex filtre mieux les informations et joue donc son rôle de cortex associatif pleinement. Chez le penseur visuel, la générativité du cerveau étant plus lente, le néocortex ne relie pas aussi bien les informations entre elles, car les lobes frontaux dans le néocortex n’ont pas la puissance de centraliser les informations éparpillées dans le cerveau comme c’est le cas dans le système de pensée verbale. Cette générativité plus lente dans la pensée visuelle engendre une interprétation défectueuse des informations, et c’est du fait de cette qualité défectueuse des informations lorsqu’elles arrivent aux lobes frontaux, que c’est le détail qui est favorisé au dépend du contexte dans la pensée visuelle.
On ne peut développer d’émotions que si l’on développe un sentiment de soi : l’impact humain de toute cause émotionnelle et de toute nuance émotionnelle qu’elles soient subtiles et moins subtiles dépendent des sentiments qu’engendrent les émotions. Pour que les sentiments exercent durablement et pleinement leur impact, la conscience est indispensable, car c’est seulement quand advient un sentiment même de soi, selon l’expression d’Antonio Damasio, que l’individu qui a des sentiments en prend conscience. Les conséquences ultimes du sentiment et de l’émotion ont pour pivot la conscience. Le sentiment dont va découler l’émotion s’enracine dans la représentation du corps par la conscience. Or, chez le penseur visuel ce type de représentation est amoindrie voire absente
Le sentiment et l’émotion sont respectivement le début et la fin d’un même processus. Alors que le premier est réservé à l’expérience mentale et subjective d’une émotion, le terme émotion désigne l’ensemble des réponses qui sont généralement observables chez l’individu. Les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent l’émotion ne nécessitent pas la conscience. Nous savons que nous ressentons des émotions et nos comportements se tissent autour de cycles émotionnels continus auxquels nous accédons grâce à la stabilité de notre arrière-plan corporel (qui est ce qui nous permet d’utiliser notre vécu de manière similaire dans une situation nouvelle), engendré par la stabilité du sentiment de soi.
Même si nous ne sommes pas toujours conscients de la naissance d’une émotion, celle-ci n’est possible que grâce à la stabilité que nous avons de nous-mêmes et c’est grâce à cette stabilité que l’émotion peut pleinement jouer son rôle. D’une part, en ce qu’elle fait partie intégrante des procédures de raisonnement, de prise d’initiative et de décision et d’autre part en ce qu’elle est l’incarnation de la logique du mécanisme de survie.
Or, pour que ces émotions d’arrière-plan dont découlent les émotions sociales fonctionnent à plein, cela nécessite que le niveau fondamental de la conscience centrale ne soit pas compromise, et que la régulation de l’état interne de l’organisme soit stable de telle sorte qu’il puisse être prêt à une réaction spécifique et adéquate. Il y a de fait une correspondance entre les classes d’inducteurs d’émotions et le degré de conscience interne de l’organisme d’où découle l’état émotionnel. L’organisme se donne alors les moyens de répondre aux stimuli de manière efficace et donc utile et utilisable. C’est la conscience centrale qui permet aux sentiments d’être connus de l’individu qui les ressent et de prouver ainsi, l’impact de l’émotion de façon interne.
Tout comportement complexe dépend de l’apprentissage, or ce sont les émotions secondaires et les émotions dites d’arrière-plan qui induisent le plus profondément l’intentionnalité et qui induisent le développement d’attitudes telles que la curiosité ou l’anticipation. Certaines hormones comme l’Ocytocine et la Vasopressine ont un rôle déterminant dans le comportement d’attachement en règle générale. L’Ocytocine joue un rôle particulièrement important dans les rapports sociaux car elle est déterminante pour la mémoire sociale : elle permet aux êtres de se reconnaître entre eux. On a supposé qu’il pouvait y avoir un lien entre l’autisme et la production insuffisante d’ocytocine, car les autistes donnent souvent l’impression qu’ils ne reconnaissent pas les personnes qu’ils voient dans un lieu qu’ils n’ont pas l’habitude de les rencontrer. Il s’agit surtout d’un problème de reconnaissance des visages et non de mémoire des visages. Or, on sait que le penseur verbal utilise l’aire du gyrus fusiforme pour accomplir cette tâche et que l’enfant autiste penseur visuel utilisera une autre aire fluctuante d’une personne à l’autre mais jamais l’aire du gyrus fusiforme [10].
Conclusion :
C’est de la pensée visuelle figurative que procède la mémoire eidétique qui contraint le sujet à associer une image à un sentiment ou à une émotion pour qu’il devienne conscient et explicite pour lui. La représentation chez le penseur visuel ne se fait pas par le ressenti comme dans la pensée verbale mais par l’image et l’image ne permet pas d’accéder aux conflits mentaux et à l’ambivalence émotionnelle : l’image est explicite par essence. Le penseur visuel n’envisage jamais aucun ressenti, il n’a pas accès à l’inhibition, le sentiment qu’il a de lui-même est plus « simple » que chez le penseur verbal, ces émotions sont toujours franches, toujours « une », jamais « pluriel ». C’est en fait le profil spatio-temporel qui diffère entre les deux systèmes de pensée et, de fait, le profil émotionnel qui en découle. Le ressenti fondé sur le vécu du penseur visuel ne donne pas accès, comme dans la pensée verbale, à un profil émotionnel de type ondulatoire qui découle des émotions d’arrière-plan. Le penseur visuel a plutôt accès à un schéma de type éclat où les sentiments et les émotions se présentent les uns derrière les autres, et se manifestent avec un démarrage relativement rapide, un pic d’intensité très fort et un déclin tout aussi soudain que ne l’a été le démarrage. En effet, le penseur visuel ne développe pas comme le penseur verbal de cycle émotionnel continu, cette soudaineté émotionnelle fait qu’il est impropre chez le penseur visuel de parler véritablement d’humeur dans la mesure où l’humeur provient du profil ondulatoire émotionnel et induit la présence d’émotions d’arrière-plan. Le concept d’humeur implique une durée, une entrée dans le temporel, donc une certaine stabilité émotionnelle qui permet de définir la personnalité. La pensée visuelle ne donne pas accès à l’humeur telle qu’elle peut se profiler dans la pensée verbale, en dehors de ses agissements le penseur visuel paraît souvent lointain aux autres et à lui-même, et l’expression de son visage reste indéfinissable.
C’est parce que le sentiment de nous-mêmes dont nous faisons expérience lorsque nous pensons quelque chose, lorsque nous percevons ou imaginons quelque chose diffère dans les deux systèmes de pensées, que de fait l’environnement n’est ni vu ni vécu de la même manière par le penseur verbal et par le penseur visuel dans la mesure où le premier développe une visée du monde et le second une vision, que les structures mentales diffèrent et n’engendrent pas le même profil émotionnel, qu’il paraît juste de penser que d’un système de pensée spécifique découle des structures mentales spécifiques donnant lieu à un schéma sentimental et un profil émotionnel propre à chacun de ces deux systèmes de pensées.
[1] « Ma vie d’autiste » Temple Grandin Editions Odile Jacob 1994
[2] « Penser en images » Temple Grandin Editions Odile Jacob 1997
[3] « L’interprète des animaux » Temple Grandin Editions Odile Jacob 2006
[4] Rudolph Arnheim la pensée visuelle Champs Flammarion 1997
[5] “l’image une vue de l’esprit. Etude comparative de la pensée figurative et de la pensée visuelle » in Recherche en communication 1998 (9) 77-99
[6] Ralph Norman Haber “Eidetic images” in Scientific American, April 1969, vol. 220 n° 4
[7] Daniel j. Povinelli “Folk physics for apes : the chimpanzee’s theory of how the world works” (p.308-311) Oxford University Press 2003
[8] “Fictions” Borges Gallimard 1956
[9] “L’erreur de Descartes” Antonio Damasio Editions Odile Jacob, traduction française 1995
[10] « Face processing occurs outside the fusiform face area in autism : evidence from fuctional MRI » Karen Pierce et al in Brain (2001)
Barbara DONVILLE
PS : Barbara Donville est l’auteur du très bon livre « vaincre l’autisme » aux éditions Odile Jacob.
SOURCE : Autisme Aveyron